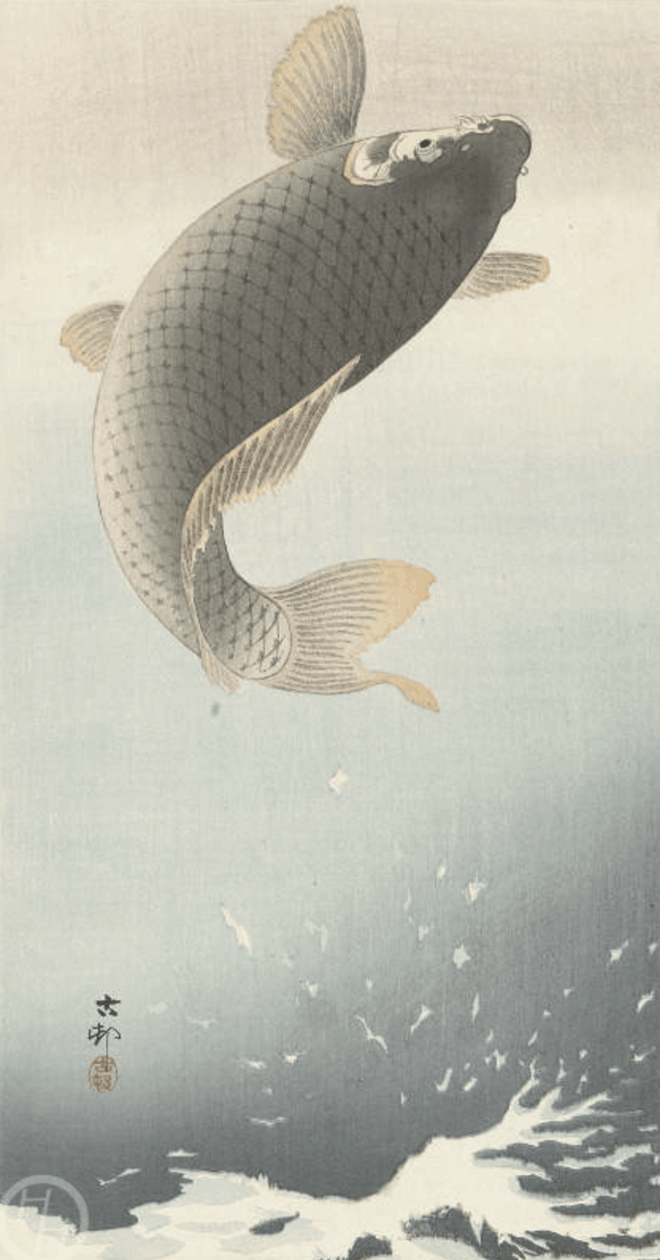Tout ce qui brille n’est pas argent… L’argenterie ne désigne pas uniquement l’argent massif ! Toutes les astuces pour le distinguer et connaître ses secrets et de fabrication et sa valeur.
Les objets d’argenterie sont d’une incroyable variété : chocolatières, cafetières, plats, saucières, écuelles, coupes, coupelles, assiettes, drageoirs, corbeilles, aiguières, moutardiers, confituriers, rafraîchissoirs, cloches, plats, bouillons avec couvercle, soupières, légumiers, timbales, huiliers, centres de table, pinces à gigot, mais aussi chaufferettes, boîtes à cigarettes ou à onguent, vases, bougeoirs, encriers, lampes à huile, encensoirs et même sculptures, meubles ou pots de chambre…

Identifier l’argent véritable
L’argent véritable s’oxyde en se recouvrant d’une fine pellicule noire. Ainsi, regardez notamment dans les recoins et les fentes pour repérer des traces d’oxydation. Nettoyé, l’argent est brillant : plus que l’aluminium et moins que le chrome.
Peser l’argenterie fait également partie des premières techniques d’identification. Le métal est plus lourd que le fer, le zinc, le laiton ou le cuivre. Sa densité est de 10,5 g/cm3. Soupesez des pièces authentiques pour prendre la mesure de la densité. Pour plus de précisions, pesez l’objet, puis plongez-le dans un récipient gradué contenant de l’eau pour calculer son volume, et ensuite sa véritable densité. Vous saurez ainsi si c’est de l’argent massif.
Le métal argenté
Le métal argenté ou placage d’argent consiste en une fine pellicule d’argent fixée au mercure au XVIIIe siècle, puis par électrolyse à partir de la fin du XIXe siècle. Plusieurs critères permettent de repérer le métal argenté : un poids souvent nettement moins élevé, de possibles traces d’usure là où la fine pellicule d’argent a disparu, d’éventuels reflets un peu dorés. Quant au poinçon, il est carré.
L’argent fourré
Au XIXe siècle, la technique de l’argent fourré répond à la forte demande d’une petite bourgeoisie en pleine expansion. L’argent est coulé autour d’un noyau fait d’un autre matériau. La couche d’argent est nettement plus épaisse que pour le métal argenté. Par sa technique même, l’argent fourré concerne des pièces relativement grandes et surtout épaisses comme les pinces à gigot ou les cuillères à sauce. Pour reconnaître ce travail, soupesez l’objet afin de ressentir une impression de légèreté par rapport à l’argent massif. Ensuite, la pièce émet un son mat et creux en la tapotant. Enfin, le poinçon est plus enfoncé (suite à la nature même du support). L’argent fourré est nécessairement utilisé pour réaliser les manches de couteau ; il faut bien que la lame d’acier se prolonge à l’intérieur du manche (recouvert d’argent), sinon le couteau se casserait en deux !

Pinces à gigot, fin du XIXe siècle.
Les alliages
Les alliages d’argent ne sont pas nécessairement moins chers que l’argent pur comme le montre le vermeil, ce mélange d’or et d’argent. En France, comme dans d’autres pays, les poinçons indiquent le pourcentage d’argent pur…
Les remontages ou assemblages
Pour donner plus de valeur à un objet ou pour le réparer, certaines personnes ont pu utiliser des pièces de différentes origines. Examinez les poignées, pieds et couvercles qui peuvent avoir été changés. Pour débusquer ces travaux, observez l’unité de style de l’objet, les techniques de fabrication, l’uniformité de la patine… Ces restaurations ne sont pas en soi une catastrophe, pour celui qui veut une belle table. Pour le collectionneur, elles feront perdre beaucoup de valeur à l’objet.
Distinguer les poinçons français
Le système des poinçons français est complexe, mais il facilite la datation. Heureusement, il existe des répertoires spécialisés. On distingue plusieurs périodes…
– Dans l’Ancien Régime (dont la pratique a perduré jusqu’aux années 1790 pour l’argenterie) : plusieurs poinçons. Le poinçon de charge de la juridiction dans laquelle a été fabriqué l’objet garantit la teneur en argent pur et comporte une lettre et un chiffre. Le poinçon de décharge du fermier général atteste le paiement de l’impôt et a souvent l’aspect d’un animal stylisé. Le poinçon du maître orfèvre a un dessin libre, original.
– A partir de 1798 et jusqu’en 1819 : trois poinçons. Celui en forme de losange est de l’orfèvre. Celui “au coq” donne le titre (le pourcentage d’argent, soit titre 1 ou 2). Celui de garantie avec une tête de vieillard, des personnages historiques ou mythologiques.
– De 1819 à 1838. Même système, mais le coq est remplacé par une figure humaine.
– Depuis 1838. L’orfèvre continue à inscrire son poinçon en forme de losange. Un seul poinçon, une tête de Minerve, remplace ceux du titre et de la garantie. On distingue deux titres. Le titre 1 (chiffre 1 dessiné à côté du casque de Minerve) signifie que l’objet comprend 95 % d’argent pur. Le titre 2 (chiffre 2) indique que l’objet est fait à partir de 80 % d’argent pur. Pour les petites pièces, on trouve parfois une tête de sanglier ou un crabe comme poinçon de titre 2.
Par ailleurs, quand l’argenterie est destinée à une grande famille, les pièces et couverts sont parfois marqués de leur blason.

Pas plus que l’estampille, le poinçon ne prouve infailliblement l’authenticité. Il existe de faux poinçons ! Des faussaires ont apposé des poinçons du XVIIIe siècle sur des pièces des XIXe et XXe siècles, car les pièces du XVIIIe sont généralement plus cotées. Un poinçon trop net, trop clair, sur une pièce prétendument ancienne est suspect. Il existe trouve aussi de faux poinçons de Minerve (donc postérieurs à 1838), mais rarement, car l’argenterie de la seconde moitié du XIXe siècle abonde et est beaucoup moins copiée. Parfois, le faussaire procède par enture, par un assemblage bout à bout invisible de deux pièces dont l’une porte un véritable poinçon ancien et l’autre non. Le résultat est une grande pièce avec poinçon.
Reconnaître les styles
Comme le mobilier, l’argenterie suit assez bien les styles de chaque époque. On retrouve ainsi l’argenterie Louis XV avec ses volutes et ses accolades, la Louis XVI néo-classique plus épurée, celle de l’époque Restauration (1815-1830) avec une accentuation de la référence à l’Antiquité classique voire avec un style dit étrusque, la Napoléon III assez chargée, celle Art nouveau 1900 avec des clins d’œil à la nature, celle Art déco reflétant un goût pour la géométrie et l’industrie…
Entretenir
Le nettoyage de l’argent se fait au blanc de Meudon ou d’Espagne dilué dans de l’alcool méthylique. Ce type de produit est vendu dans le commerce, comme d’autres. Ne mettez pas l’argent en contact avec une matière contenant du souffre ; celui-ci favorise l’oxydation. De même, évitez le vinaigre. Il existe des feutres anti-oxydation pour emballer l’argenterie.
Le marché de l’argenterie
Chocolatières, légumiers et autres pièces de formes prestigieuses sont bien cotés, car recherchées par des collectionneurs et des amateurs avertis. L’aspect sculpture plaît. Il est de plus en plus admis qu’une pièce de forme soit d’un style différent des couverts. Les ménagères somptueuses en argent massif avec tous les couverts et ustensiles possibles sont appréciées, les Napoléon III. Les ménagères n’ont pas de couteaux entièrement en argent, sauf ceux à poisson : les lames sont en acier. Il existe aussi un marché typiquement de collection avec les tastevins ou les gobelets de baptême.
L’importance du nom
Pour les pièces antérieures à 1800, le nom du centre de production a son importance : Lille, Valenciennes, Paris, Nantes, Rennes, Strasbourg… Mais c’est surtout l’attribution d’une pièce à un maître orfèvre de renom qui participe à sa valeur, sans oublier la qualité d’exécution ! Au XIXe siècle, les grandes maisons sont les centres de production. Ces noms contribuent à valoriser l’objet.

– Ancien Régime :
Entre parenthèses, la date d’accession à la maîtrise.
Bertin Merger (1695).
Claude Mangin (1699)
Aymé Joubert (1703).
David Delafons (1718).
Claude Duvivier (1720).
Louis Henri le Gaigneur (1732).
Jean Fauche (1733).
Guillaume Ledoux (1736).
Edmé-Pierre Balzac (1739).
Pierre Joseph Pontus (1746).
Honoré Burel (1748).
Jean-François Balzac (1749).
Robert-Joseph Auguste (1757).
Alexandre de Roussy (1758).
Jean-Baptiste Cheret (1759).
Jean-François Jouet (1765).
Pierre Charles Micalef (1773).
Jean-Charles Mongenot (1775);
Claude-Isaac Bourgoin (1779);
Jean-Baptiste Odiot (1785). Poursuit sa carrière au XIXe siècle.
– Début du XIXe siècle :
Marc Jacquart.
Marc-Auguste Lebrun.
Pierre Bourguignon.
– Grandes maisons des XIXe et XXe siècles :
Entre parenthèses, la date de fondation.
Odiot (1690).
Christofle (1842).
Puiforcat (1820).
Tétard (1880).
Richard (1910).